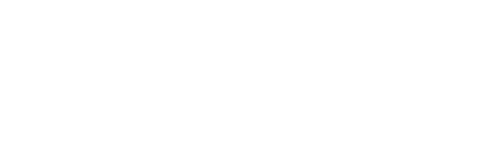Découvrez notre entrevue avec Alejandra Coll Agudelo, avocate féministe, spécialiste en droit pénal, genre et violence sexuelle.

« La justice continue d'exiger des victimes qu'elles s'adaptent à un système qui n'a pas été conçu pour elles » — Alejandra Coll Agudelo
L’avocate revient sur son engagement professionnel, les limites du système judiciaire face aux violences sexuelles et les évolutions nécessaires pour garantir un accès à la justice plus équitable. Elle partage une vision critique et lucide du droit pénal colombien, ancrée dans l’expérience de terrain. À travers ses recherches et son engagement sur le terrain, Me Coll Agudelo nous offre une lecture percutante de la réalité des victimes de violences sexuelles et appelle à une transformation systémique bien au-delà du cadre judiciaire, où les victimes soient bien au centre de la solution.
Il s'agit de la traduction française de l'entrevue menée en espagnol
Pour commencer, racontez-nous brièvement votre parcours professionnel. Comment avez-vous été amenée à vous spécialiser dans le droit pénal et, en particulier, dans les violences sexuelles ?
Je suis avocate féministe, titulaire d'un master en études de genre. J'ai travaillé principalement sur les droits des femmes, la paix et les droits reproductifs. Je suis actuellement agente de la fonction publique en Colombie, mais j'ai travaillé dans des organisations de défense des droits en matière de sexualité telles que Women's Link, le Centre for Reproductive Rights (LAC Programme) et la Ruta Pacifica de las Mujeres.
Les questions de violence sexuelle ont été transversales à tous les postes que j'ai occupés au cours de ma carrière, ce qui m'a prouvé qu'il s'agit d'une question généralisée, d'une question de santé publique, qui apparaît dans toutes sortes de contextes. J'ai été enquêteuse pour la Commission de la vérité, où j'ai participé à l'enquête sur les crimes sexuels.
Vos travaux ont porté sur des questions essentielles du droit pénal colombien. Quelles sont les principales conclusions de vos recherches les plus récentes sur la violence sexuelle ?
Les recherches les plus récentes que j'ai menées sur ces questions concernaient la violence sexuelle dans le contexte du conflit armé. Elles s'inscrivaient dans le cadre de la Commission de la vérité en Colombie. L'une des principales conclusions a été que la violence sexuelle fait partie des stratégies de contrôle territorial des acteurs armés et qu'elle est utilisée aussi contre les femmes qui font partie du groupe armé. Cette violence a été utilisée pour intimider, contrôler, obtenir des informations et faire régner la terreur.
Au cours de ces investigations concrètes, je me suis appuyée sur les concepts de justice transitionnelle créés en Colombie, plutôt que sur le droit pénal. Cependant, il était nécessaire d'analyser les dossiers sur la base du droit pénal, de comprendre ses méthodes et ses outils, afin de réaliser une enquête complète.
J'ai également eu l'occasion de plaider en droit pénal, en accompagnant des femmes victimes de différentes formes de violence. Cet exercice m'a permis de conclure que la dépendance économique, le manque de connaissance des outils juridiques existants et la pression sociale et émotionnelle, ce sont des facteurs qui génèrent l'incidence élevée de la violence à l'égard des femmes en Colombie. Ce phénomène touche les femmes de toutes les couches et origines socio-économiques, de tous les âges et de tous les niveaux d'études, entre autres facteurs. Les trois éléments mentionnés (dépendance économique, manque de connaissance des outils juridiques existants et pression sociale et émotionnelle) sont le dénominateur commun des cas.
En même temps, j'ai pu constater que le système judiciaire dispose d'outils limités pour saisir la singularité des cas, et surtout pour comprendre que les contextes sont divers et que chaque victime a des besoins différents. Les protocoles de prise en charge rigides sont l'un des grands ennemis des femmes victimes, qui sont obligées de s'adapter à des structures qui n'ont pas été conçues pour elles. Et ce qui est complexe, c'est que ce processus d'adaptation aux schémas imposés par les États doit se faire dans un contexte de violence, et même de risque pour la vie des victimes.
Ces dernières années, des débats ont eu lieu dans différents pays sur la nécessité de réformer les normes relatives à la violence sexuelle. D'après votre expérience, comment évaluez-vous l'évolution du droit pénal colombien dans ce domaine ?
En Colombie, il y a eu des avancées juridiques, notamment en ce qui concerne la violence sexuelle dans les conflits armés. La Colombie dispose d'une loi spécifique (loi 1719 de 2014) qui crée un protocole de prise en charge spécifique et reconnaît les besoins particuliers des femmes qui ont subi cette forme de violence. En dehors du contexte du conflit armé, des progrès ont été réalisés dans la construction de formes de violence sexuelle qui n'étaient pas reconnues auparavant, comme le harcèlement sexuel qui, en Colombie, n'existe formellement en tant que délit que depuis 2008.
La Cour constitutionnelle colombienne a progressé en termes de droit pénal, surtout en indiquant un régime de preuve spécial et différencié, en exprimant la portée du consentement comme un élément central dans l'analyse de ces crimes, en créant des mesures spéciales pour l'enquête sur les cas impliquant des enfants, entre autres facteurs.
Cependant, nous sommes encore loin d'une mise en pratique effective des normes établies par la Cour constitutionnelle. La Colombie est signataire de la Convention de Belém do Pará pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, mais malgré cela, les normes élevées en matière d'enquête criminelle dans les cas de violence sexuelle ne sont toujours pas respectées et, surtout, l'impunité dans les affaires dépasse toujours les 90 %.
Le concept de consentement a été un point clé des réformes juridiques dans d'autres pays, comme l'Espagne avec la loi « seul le oui est oui ». Pensez-vous que la Colombie devrait adopter une approche similaire et quel serait l'impact sur le système judiciaire et la protection des victimes ?
En Colombie, il y a un développement jurisprudentiel important dans le domaine du consentement en droit pénal. Ce développement signifie qu'une norme n'est pas nécessaire, à mon avis, pour le moment, puisque le respect des normes établies par des tribunaux tels que la Cour constitutionnelle et la Cour suprême de justice en tant qu'organes phare de la justice devrait être plus que suffisant.
S'il est vrai que le droit pénal colombien est profondément légaliste, la jurisprudence a réussi à gagner une place essentielle dans le scénario judiciaire en Colombie face aux retards du Congrès dans l'actualisation du droit pénal avec la société.
D'autre part, le Congrès colombien ne semble pas, ces derniers temps, être en phase avec les débats qui traversent la société colombienne. Une réforme visant à élargir les possibilités d'euthanasie dans le pays a été rejetée, de sorte que la réglementation établie par la Cour constitutionnelle par le biais d'arrêts restera en vigueur. On peut dire que les hautes juridictions colombiennes sont ainsi parvenues à combler les lacunes du Congrès en matière d'adaptation du droit pénal à l'évolution de la société.
Malgré les avancées législatives, de nombreuses victimes se heurtent à des obstacles dans les procédures judiciaires. Dans le contexte colombien, quels sont les principaux obstacles à l'accès à la justice dans les cas de violence sexuelle ?
Les obstacles documentés par les organisations de femmes en Colombie sont nombreux.
- Manque de garanties pour la sécurité des victimes une fois qu'elles ont porté plainte. Certaines victimes ont des difficultés à recevoir une protection en raison des limites des capacités institutionnelles et parce que parfois, bien que cela ne soit pas obligatoire, de nombreuses femmes sont exposées à leurs agresseurs pendant les procédures judiciaires elles-mêmes. Cela décourage les femmes de porter plainte, car beaucoup d'entre elles craignent pour leur vie. Bien que la loi 1257 de 2008 crée un large éventail de mesures de protection, celles-ci ne sont généralement pas utilisées et se limitent à des mesures policières.
- Défauts dans la procédure visant à éviter une revictimisation.
- Défaillances dans le processus de réparation intégrale.
- Défaillances dans les processus d'assistance sociale pour les cas de dépendance économique vis-à-vis de l'agresseur. Cela inclut des stratégies d'employabilité avec une approche différentielle.
- Échecs dans les processus de prise en charge psychosociale.
- Le manque de formation des médias sur la communication adéquate de ces affaires judiciaires.
- Manque de cohérence et de synergie entre les procédures civiles relatives à la famille, notamment l’autorité parentale et la garde des enfants, et les procédures pénales.
Le système judiciaire peut parfois revictimiser les personnes qui signalent des agressions sexuelles. Quels changements structurels ou réglementaires pourraient être mis en œuvre pour garantir des procédures plus sensibles et plus efficaces pour les victimes ?
Cette question est très vaste, mais si je devais choisir deux changements structurels qui pourraient être mis en œuvre, ils seraient les suivants : 1) Élargir l'éventail des mesures de protection qui existent dans le pays pour les personnes exposées à la violence ; 2) Développer en détail les mécanismes de réparation des dommages causés à ces victimes.
A mon avis, selon ma vision non-punitiviste et minimaliste du droit pénal, les changements structurels devraient se situer avant tout au niveau social et culturel, plutôt qu'au niveau du droit pénal. Je crois profondément en un droit pénal de dernier recours, où le droit pénal est utilisé comme une dernière option. La culture pénale latine le considère au contraire comme la première option, ce qui n'a évidemment pas permis de protéger efficacement les femmes et les jeunes filles.
De véritables changements structurels doivent être apportés en promouvant une culture de la non-violence, de la prévention et de la détection précoce des cas afin qu'ils ne se reproduisent pas. Il est évidemment nécessaire de renforcer les mécanismes de réponse du droit pénal lorsque les cas se sont déjà produits, mais je pense que ce renforcement doit être de nature profonde, y compris une meilleure formation et de meilleures conditions de travail pour les fonctionnaires de l'État, plus de personnel, entre autres aspects.
L'idée selon laquelle l'alourdissement des peines constitue une réponse adéquate aux crimes commis contre les femmes et les jeunes filles s'est largement révélée inefficace. Les délinquants ne sont pas dissuadés par de telles actions.
Dans d'autres pays, des crimes tels que le stealthing et le revenge porn ont été criminalisés. Comment la Colombie aborde-t-elle ces phénomènes dans son droit pénal et pensez-vous que des réformes spécifiques sont nécessaires ?
La Colombie n'a pas beaucoup progressé dans ces débats. Le stealthing a été étudié par le Congrès en tant que facteur aggravant des crimes sexuels, mais le débat n'a pas abouti. Certaines décisions de la Cour constitutionnelle sur le consentement et son développement pourraient s'appliquer à cette situation.
Les progrès sont beaucoup plus importants en ce qui concerne le mal nommé revenge porn qui, en Colombie, est un crime, aggravé lorsqu'il implique des mineurs. La Colombie progresse en matière de violence sexuelle numérique depuis la loi 762 de 2002, qui a marqué le début d'une série de changements législatifs visant à protéger les personnes victimes de crimes sexuels, y compris l'exposition non consensuelle de vidéos à caractère sexuel. Depuis 2018, la Colombie a ratifié la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, qui prévoit des mesures et des obligations spécifiques en matière de violence sexuelle numérique.
Une fois encore, malgré l'existence d'un cadre normatif solide en droit pénal, le problème fondamental reste l'application et la mise en pratique de ces normes.
Les universités et autres établissements d'enseignement peuvent jouer un rôle clé dans la prévention de la violence sexuelle et la promotion du consentement. Quelles sont les stratégies que vous considérez comme essentielles dans ce domaine ? Quelles actions devraient être prioritaires en Colombie pour lutter plus efficacement contre la violence sexuelle ?
En termes de prévention, l'éducation sexuelle intégrale (conformément aux normes de l'affaire Guzmán Albarracín c. Équateur de la Cour interaméricaine des droits de l'homme) est la clé dont l’efficacité a été démontrée par de nombreuses recherches dans ce domaine. Les filles et les femmes qui sont informées sur la manière d'identifier la violence à un stade précoce sont moins sujettes à la violence. La formation à la masculinité non violente est essentielle à la prévention. Ce qui est triste, c'est qu'en Colombie, depuis 2016, il y a une opposition acharnée à toute forme d'éducation sexuelle.
En termes de politique pénale, il est essentiel de renforcer les outils de protection des victimes dans le cadre du droit pénal, ainsi que la formation adéquate et permanente des fonctionnaires du pouvoir judiciaire, accompagnée d'une stratégie de permanence dans les postes afin de garantir que la formation ne soit pas perdue.
Mars 2025